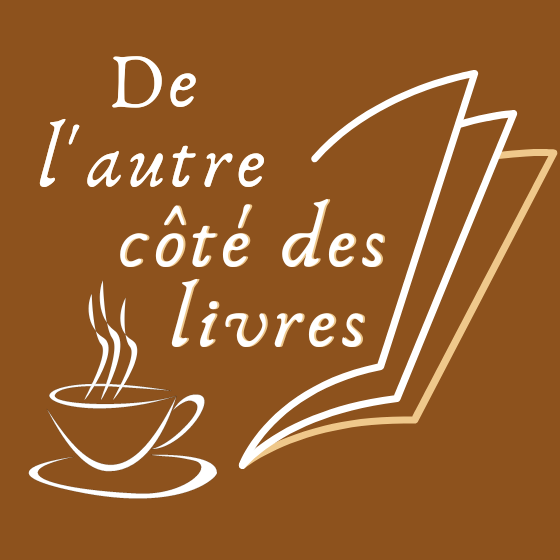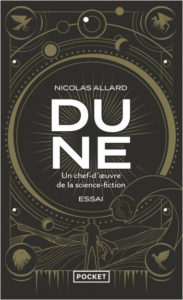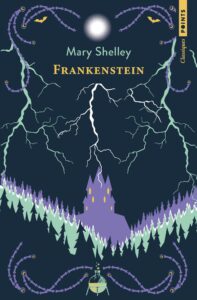 Après Carmilla, plongeons-nous dans un autre classique de la littérature à la fois fantastique, mais également de science-fiction : Frankenstein de Mary Shelley. Si le mythe m’est familier, comme à toute personne s’intéressant aux œuvres d’imaginaire, j’avoue que je n’avais pas relu en entier le livre depuis…. quelques décennies en étant large. La version choisie pour cette redécouverte est celle récemment traduite et modernisée par Elisabeth Vonarburg.
Après Carmilla, plongeons-nous dans un autre classique de la littérature à la fois fantastique, mais également de science-fiction : Frankenstein de Mary Shelley. Si le mythe m’est familier, comme à toute personne s’intéressant aux œuvres d’imaginaire, j’avoue que je n’avais pas relu en entier le livre depuis…. quelques décennies en étant large. La version choisie pour cette redécouverte est celle récemment traduite et modernisée par Elisabeth Vonarburg.
Au cas où vous ne vous rappeliez pas l’histoire classique, voici un bref résumé. Victor Frankenstein, un étudiant suisse passionné par l’alchimie et la philosophie naturelle, donne vie à une créature. Soudain frappé par l’horreur de son acte, il s’enfuit et abandonne sa création qui va dès lors le poursuivre et l’accabler de malheurs jusqu’à ce que les deux trouvent leur fin dans les étendues glacées du pôle Nord.
Et l’histoire nous est présentée par une série de récits enchâssés les uns dans les autres. D’abord les lettres qu’envoie Robert Walton à sa sœur pour lui raconter sa tentative d’exploration de la banquise où il croisera successivement la créature et le créateur. Ensuite le récit de Victor Frankenstein lui-même, puis celui de la créature découvrant le monde, l’humanité et les différents rejets qu’elle rencontrera.
À la lecture, deux éléments en particulier m’ont frappé. Le premier est l’âge de Victor Frankenstein : contrairement à la plupart des adaptations cinématographiques ou télévisuelles qui le dépeignent comme un homme mûr, dans le récit c’est un tout jeune homme, même pas doctorant. Il n’a que 17 ans quand il se lance dans son projet, 19 ans quand il donne vie à la créature et bien moins de 25 ans quand raconte son histoire à Robert Walton. Le deuxième est l’absence de scènes purement horrifiques. Là, où Hollywood va détailler l’assemblage de la créature et sa naissance orageuse, Mary Shelley l’évacue en quelques pages et ne donne aucun détail sur la façon dont Frankenstein s’y prend. De même, les victimes meurent le plus souvent par étranglement simple. Finalement le plus horrifique à lire en 2025 est une banale conversation au bord d’une Mer de Glace toujours bien présente et dont la traversée à pied reste dangereuse et longue en ce tout début de XVIIIe siècle, alors que le lieu est désormais quasi à sec.
En revanche, l’autrice insiste sur l’atmosphère générale, les paysages variés (de la Suisse au pôle Nord en passant par Livourne, la Hollande ou l’Irlande…) traversés par les différents narrateurs et les sentiments habitant les différents personnages du livre. C’est parce que la plupart des victimes sont dépeintes avec force détails et de façon très positive que la lectrice s’attache à eux, et compatit avec la souffrance de leurs entourages au moment de leur mort.
Et si finalement, relire Frankenstein m’a surpris, car les différentes déclinaisons du mythe avaient pas mal modifié mes souvenirs, j’ai apprécié cette lecture et les implications philosophiques qu’elle propose sur ce qu’est un monstre, comment être une victime peut vous transformer en bourreau et vice-versa, et sur la responsabilité parentale et les relations entre la nature et l’éducation. Et le texte court au style certes daté (malgré la modernisation de la traductrice) reste très plaisant à lire et résonne encore en 2025 comme il résonnait lors de sa première parution en 1818, peut-être sur des points différents.
Frankenstein
de Mary Shelley
Traduction d’Elisabeth Vonarburg
Éditions Points